J’ai terminé ma lecture de Ma terre empoisonnée il y a quelques semaines avec beaucoup d’émotions. Ce qui devait être une critique très basique s’est transformée en une longue discussion avec moi-même sur ce que ce livre m’a apporté en termes de point de vue sur la guerre du Vietnam. Beaucoup de sujets soulevés par Tran To Nga à travers son témoignage ont secoué mes idées reçues, m’apprenant au passage énormément sur cette période historique, et je ne me voyais plus en faire une critique littéraire lambda. Cet article constitue donc les réflexions que le livre m’a inspiré. Je n’ai pas pu m’empêcher de rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez garder la surprise de la lecture intacte, cet article n’est donc sans doute pas pour vous. En revanche, si vous ne vous sentez pas de lire les 300 pages mais que vous êtes intéressé, et aussi parce que c’est une lecture qui peut être difficile et sensible pour la diaspora vietnamienne, j’aborde beaucoup de passages du livre que je considère importants et qui peuvent faire office de résumé.
L’histoire du Vietnam a longtemps été indissociable de mon identité. Comme beaucoup d’enfants français issus de la diaspora qui n’ont jamais connu leur pays d’origine, j’ai compris très tôt que “Vietnam” était automatiquement attaché à la “guerre du Vietnam” dans l’imaginaire collectif. Pas seulement parce qu’elle était la réponse à la sempiternelle question: ”Comment ta famille s’est retrouvée en France ?”, mais aussi parce qu’en terme de représentation, c’était souvent la première image qui apparaissait dans tous les médias; au cinéma, dans les livres, mais aussi dans la musique (je me souviens avoir cherché des playlists de musique vietnamienne sur Spotify, pour ne tomber que sur une infinité de playlists de chansons américaines contre la guerre du Vietnam…). L’expression “avoir fait le Vietnam” ou même juste “Nam” pour désigner la guerre du Vietnam participent aussi à associer le conflit et le pays, jusqu’à faire oublier que le Vietnam est aussi un peuple avec une culture, une langue, et sa propre histoire, avant et après la guerre.
Et malgré cette inévitable association, il est très difficile d’avoir un aperçu plus intime de cette période historique qui semble pourtant si proche. Cela a longtemps été trop “complexe” pour m’être expliqué par ma famille qui l’avait pourtant vécu, trop simplifié dans les cours d’histoire, et puis en grandissant, on finit par comprendre par bribes que tout se résume à un simple énoncé : le méchant communiste a gagné, les américains ont perdu, et tout ceci n’était qu’une étape de la guerre froide, celle-ci, par contre, bien présente et nommée dans les manuels d’histoire.
Alors bien entendu, les idées reçues et la description occidentale largement majoritaire qui est faite du conflit auront eu raison de ma perception, aussi néfastes soient-ils. Très grossièrement, pour moi, la guerre du Vietnam n’était qu’un contexte au développement d’une histoire purement américaine imbibée de relents coloniaux ; l’homme blanc s’aventure sur les terres sauvages et hostiles du Vietnam pour sauver les bons vietnamiens des vilains communistes, tout cela sous une pluie torrentielle et les pieds dans la boue. Éventuellement, l’américain souffre de sa présence dans cette guerre, par laquelle il ne se sent pas forcément concerné. Qu’ils critiquent ou célèbrent la guerre, ces films et séries américains ont tous pour point commun de mettre l’homme blanc au centre de leur récit. Les vietnamiens dans tout ça sont assez peu présents. Je pense par exemple à la prostituée dans cette scène de Full Metal Jacket, première femme vietnamienne que je voyais représentée dans un film, avec son visage très maquillée, sa mini-jupe et sa démarche aguicheuse, son accent surtout, lorsqu’elle négocie son prix, et qui appelle au rire. Pour ce qui est d’Apocalypse Now, je ne l’ai vu que récemment, et même si c’est un film que je trouve intéressant à de nombreux niveaux, la représentation des vietcong m’a beaucoup choquée. Le peuple vietnamien n’y est qu’une masse sans visage, animalisée. Là où les soldats américains sont dépossédés progressivement de leur humanité au fur et à mesure qu’ils s’enfoncent dans la jungle, les vietcong, eux, ne bénéficient pas de ce privilège. Ce sont des animaux à l’écran, et dans la bouche des personnages. Dans la dernière partie du film, alors que le récit en vient à son dénouement, les vietnamiens ne sont même plus des vietnamiens mais une tribu indigène filipino engagée par la production en dernière minute (tout le monde connaît les circonstances désastreuses de la production, désormais légendaires, de ce film). Les sud-est asiatiques sont donc interchangeables. Ils ont la peau foncée, leurs pieds et leurs torses sont nus et maculés de boue, et ils ne semblent pas posséder de langage. Je trouve ça d’autant plus frappant que dans ces deux exemples – Full Metal Jacket et Apocalypse Now – la guerre est loin d’y être célébrée. On y assiste au contraire à l’expression des pires cruautés, à l’humanité dans ce qu’elle a de plus sombre, comme pour dire : “Voilà ce que la guerre fait faire aux hommes”. Et pourtant, les vietcong y sont systématiquement présentés comme une caricature d’ennemi, sans aucune remise en question en terme de représentation, et avec un imaginaire très imprégné de colonialisme.
Pour toutes ces raisons, cette lecture de Ma terre empoisonnée de Tran To Nga fût un énorme coup de pied dans mes perceptions et mes croyances au sujet de la guerre du Vietnam. Il s’agit d’un seul coup de retourner le point de vue sur le conflit et de s’immiscer au coeur de l’armée vietcong, de donner des motivations et des visages à la lutte pour la libération du Vietnam pour se débarrasser des clichés coloniaux, et essayer de mieux comprendre cette histoire si présente dans les médias, et pourtant si méconnue.
Tran To Nga commence son récit par le diagnostic tardif de sa maladie dont elle connaît bien la cause. Soumise à la pulvérisation de Napalm sur les terres vietnamiennes lors de la guerre contre les États-Unis, elle a souffert toute sa vie de symptômes causés par l’empoisonnement. Ce constat déjà saisissant sert de point de départ à un récit autobiographique palpitant, mais aussi insoutenable. C’est un parcours à travers un Vietnam post-colonial meurtri et assoiffé de liberté, une liberté qui sera acquise par les armes et malheureusement, au sacrifice de nombreux révolutionnaires.
Le fait que les conséquences de la guerre de Vietnam ne soient pas seulement implicites mais aussi palpables encore aujourd’hui physiquement dans les corps des survivants (enfants handicapés, anciens soldats souffrant de maladies chroniques dans les deux camps) est déjà poignant en soi. Je n’en ai pour ma part jamais entendu parlé auparavant. Il est bien possible que ce soit par pure ignorance, mais je ne peux m’empêcher de penser que la responsabilité, portée par des multinationales qui font encore poids aujourd’hui dans la production d’insecticides pour l’agriculture mondiale, n’est pas un hasard dans cette ignorance. Pour sûr, Monsanto et compagnie auront fait leur travail pour étouffer ce crime atroce. En effet la puissance de Monsanto n’est plus à démontrer, car malgré les conséquences terribles de l’utilisation, entre autres, du RoundUp dans le traitement des sols, la multinationale est encore largement protégée par les États qui l’utilisent. La proximité entre Monsanto, producteur d’insecticides, et l’armée américaine est déjà une réalité terrifiante. Cette multinationale qui s’est spécialisée pendant un temps dans la création d’un agent chimique à l’impact aussi meurtrier a tout de même pu devenir un des vendeurs privilégiés de l’industrie agro-alimentaire. Et même si beaucoup de soldats américains touchés par le produit ont pu obtenir gain de cause devant la justice, il n’en va pas de même pour les vietnamiens qui ont vu leurs terres devenir incultivables durant des années, et ont engendré des générations d’enfants malades et handicapés, empoisonnés à vie par l’agent orange…
D’un point de vue plus personnel, il est absolument déchirant de lire le passage de Tran To Nga sur la naissance de sa fille Viet Hoa, née dans le maquis. Le bébé déjà malade, décède après quelques mois de vie, et l’autrice culpabilise pendant une grande partie de sa vie de l’avoir fait naître au coeur de la guerre. Elle n’apprend la cause de son mal, l’agent orange, qu’à un âge avancé, en même temps qu’elle comprend ses propres problèmes de santé et ceux de ses deux autres filles. On comprend alors d’où vient la force avec laquelle Tran To Nga a combattu les multinationales responsables de l’agent orange le reste de sa vie.
Il est également fascinant de voir comment Tran To Nga fait de l’idéologie communiste un point central dans son récit. C’est un fil rouge auquel elle revient constamment, pour parler de la solidarité entre combattants vietnamiens, de la volonté de s’émanciper de la France, dans l’entraide entre victimes de l’agent orange, et dans l’éducation qui a constitué une part importante de sa vie après la guerre. Elle met en avant le contraste entre les motivations du parti communiste de cette époque et l’application de ces principes après la guerre. Là où les militants et révolutionnaires voyaient la paix, l’équilibre, un retour à la sérénité et à la solidarité, s’est au contraire élevé un climat de tension renforcé par une impitoyable chasse aux sorcières. Le gouvernement se mettait à persécuter ceux-là mêmes qui s’étaient battus pour la victoire du parti.
Il est assez inhabituel de voir ce contraste clairement exprimé. Comme je le disais plus haut, le point de vue occidental montre les vietcong comme de dangereux terroristes tentant d’imposer un régime dictatorial. L’idéologie elle-même est complètement effacée. Or si l’on remet les choses dans leur contexte en se basant sur le témoignage de Tran To Nga, il faut comprendre que les vietcong étaient pour la grande majorité des combattants volontaires, tenaces car animés par un patriotisme sincère et motivés par une idéologie à laquelle ils croyaient. Il s’agissait réellement d’une révolte menée par un peuple conscient des problèmes causés par la colonisation française, et qui essayait de faire changer ce système de dépendance pour gagner en autonomie, et ce par ses propres moyens. On est loin de l’image de dictature présentée par les médias et les fictions sur le sujet… Est-ce que l’exécution de cette idéologie après la guerre fut un échec ? Oui, sans aucun doute. Les inégalités de l’avant-guerre n’ont fait que prendre une autre forme, dès que de nouveaux dirigeants se sont appropriés la cause et ont cessé de penser le peuple au coeur de leur combat. Mais les revendications vietcong étaient-elles, depuis le début, une attaque contre la démocratie ? Rien n’est moins sûr… Évidemment il est clair que le témoignage de Tran To Nga sur le sujet est biaisé. Elle a été une vietcong très fière de ses convictions, et déçue par la tournure des événements après la guerre. Mais c’est une réflexion à contre-courant qu’il est important d’avoir quand la plupart des œuvres sur cette période s’appliquent à ne montrer qu’un visage de l’idéologie communiste vietnamienne. En vérité, Tran To Nga nous dit que le Vietnam d’avant-guerre était loin d’être un paradis sur terre, et même une parodie de démocratie contrôlée par des dirigeants français qui menaient une politique coloniale en toute impunité, et ce malgré la déclaration d’indépendance… Au-delà de questionner la perception de l’armée vietcong, cela en dit également beaucoup, je pense, sur la légitimité des États-Unis à entrer en guerre contre le Vietnam du Nord. Le pays se voyait alors comme un parfait exemple de démocratie, prêt à défendre le “Vietnam opprimé”. Force est de constater qu’à travers les yeux de Tran To Nga, c’était loin d’être aussi simple. Si l’on passe sur le fait que les États-Unis ont empoisonné sur plusieurs années les terres qu’ils étaient censés défendre, ont eux-même placé des traîtres parmi les vietnamiens pour semer la zizanie dans un système politique plutôt organisé, c’est aussi la démarche en elle-même, qui est à questionner. Sur le sujet de l’intervention américaine dans des pays communistes, je ne peux que vous conseiller ce court-métrage documentaire de Ken Loach sur le coup d’état du 11 septembre 1973 au Chili, une tragédie dont les États-Unis sont en partie responsables. Il semble y avoir un motif dans ces interventions anti-communistes qui consiste à dire qu’en tant que détenteurs d’une vérité politique, cette puissance mondiale se devait de rappeler à l’ordre les populations de pays plus faibles concernant des élections qui, contrairement à ce qui a pu être dit, étaient loin d’être anti-démocratiques, bien au contraire…
L’aspect politique mis à part, le témoignage de Tran To Nga est très précieux d’un point de vue historique, et nous apprend beaucoup sur les stratégies de combat des soldats vietcong, sur l’organisation de la résistance, et plus généralement, sur la vie des soldats et des civils pendant cette période tourmentée. J’ai trouvé l’approche de l’autrice particulièrement touchante, car elle s’attarde beaucoup sur ses rencontres et amitiés qui ont façonné son expérience en tant que résistante et vietcong. Même si l’autrice entre avec beaucoup de détails saisissants dans la rudesse de la vie dans la jungle, la violence des affrontements et l’horreur de certains événements auxquels elle a assisté, une joie et un enthousiasme étonnants semblent éclore de son témoignage, aux moments les plus inattendus. Elle ne manque jamais de citer ses camarades de route qui ont partagé leur repas avec elle quand elle était trop fatiguée après une journée de marche, les femmes qui l’ont soutenue dans sa grossesse difficile, les éclats de rire et les blagues qui fusaient entre ses compagnons de fortune malgré les bombardements incessants. Même si les combattants côtoyaient la mort au quotidien, c’est une impression de vie qui ressort par-dessus tout, la chaleur de la camaraderie, et bien-entendu, toujours dans cette thématique du communisme, l’élan de solidarité, et l’étincelle révolutionnaire.
De plus, pour mon plus grand plaisir, les femmes sont omniprésentes dans le livre. L’implication des femmes dans les révolutions et les mouvements communistes et anarchistes m’ont toujours passionnée. Notamment parce que, bien que le féminisme soit inséparable de l’idéologie libertaire (comment prétendre libérer le peuple sans libérer les femmes ?), il arrive souvent que les femmes soient délaissées de la lutte, avant d’être complètement effacées de l’histoire. Pourtant, certains auteurs et autrices s’efforcent de rappeler que les femmes ont activement participé aux révolutions, que ce soit en soutenant les combattants, dans des rôles d’infirmières, en créant une presse libertaire féministe (c’est le cas des Mujeres Libres durant la guerre d’Espagne par exemple), ou même en prenant les armes, ce qui était bien plus courant que ce qu’on peut croire.
La guerre du Vietnam ne fait pas exception, et Tran To Nga prend soin de rappeler l’implication des femmes dans les combats et dans la résistance, a commencer par sa propre famille. D’abord inspirée par sa mère qui fut une figure importante de la libération du Vietnam et qui combattit elle aussi pendant la guerre, Tran To Nga s’est engagée très tôt pour son pays et ne dissimule pas son patriotisme exacerbé. Dès son enfance, sa mère lui faisait passer des mots pour la résistance, et cet héritage lui est resté jusqu’à ce qu’elle prenne les armes à son tour. Même si elle a été mariée, et à un homme lui aussi très actif pour le front de libération du Vietnam, elle précise que ce fût une relation majoritairement à distance ou chacun d’eux mettait son patriotisme avant le couple, ce qui en soit est déjà assez hors-norme pour être soulevé. De plus, Tran To Nga est devenue mère pendant la guerre. Elle a accouché seule sur le front, et elle était loin d’être la seule femme dans ce cas, selon son témoignage. Même enceinte, elle n’a pas cessé de combattre auprès de ses pairs masculins, au risque de mettre en péril sa grossesse. Au-delà de cette preuve de courage incroyable, je trouve qu’il s’agit d’une situation très avant-gardiste pour une femme de cette époque.
Cela étant dit, les conditions de vie de ces femmes combattantes étaient assez terribles. Bien sûr, comme les vietcong vivaient dans des camps temporaires au milieu de la jungle, il n’y avait pas d’accès à des infrastructures pouvant garantir le minimum d’hygiène, et aucun moyen mis en place pour permettre aux femmes enceintes de se soigner ou d’accoucher dans de bonnes conditions. L’autrice parle avec douleur des épreuves qui lui a fallu traverser pour que sa fille malade puisse être auscultée, ou même avoir accès à des soins rudimentaires. Sa culpabilité face à la mort de sa fille en est d’autant plus déchirante, car bien sûr, le meilleur hôpital du monde n’aurait pu sauver ce bébé empoisonné avant de naître.
Un autre passage particulièrement difficile à lire fut la détention de Tran To Nga, enceinte de son deuxième enfant au moment des faits. Si elle précise que sa grossesse lui a garanti une certaine sympathie de la part de ses camarades de cellule et de ses geôliers, les séances de tortures et les conditions d’emprisonnement n’en restent pas moins atroces. Tran To Nga explique aussi sa réticence à bénéficier d’un traitement de faveur malgré sa grossesse, car elle a peur d’être prise pour une traîtresse par son propre camp et de subir des représailles à sa sortie. En tant que femme et mère, elle est donc piégée à tous les niveaux. Lors de sa détention, sa grossesse et son statut de mère sont utilisés comme moyens de pression, car on menace de s’en prendre à sa fille si elle ne collabore pas. Mais lorsqu’on lui accorde des privilèges liés à sa condition, elle a peur d’être rejetée par son camp. Malgré tout, Tran To Nga fait preuve d’une grande ténacité et d’un courage exceptionnel, ne cède jamais aux menaces et tient bon jusqu’à la libération, sans jamais trahir ses camarades, ni ses principes.
Comble d’ironie, sa grossesse et sa féminité sont utilisés contre elle après la libération, lors de la chasse aux sorcières menée par le gouvernement : on l’accuse d’avoir parlé, car on ne peut croire qu’une femme frêle et enceinte ait pu résister à la torture.
“Autant le dire: J’ai tout pour être suspecte et mes inquisiteurs, perclus de préjugés machistes, ne tardent pas à me le faire comprendre. Pour eux, une jolie femme, issue de surcroît d’une classe non prolétarienne, n’a pas pu résister à l’étau de la prison.”
Cet exemple terrible montre à quel point une femme combattante sort finalement toujours perdante, quelle que soit sa solidité et sa loyauté envers sa cause. C’est dans ces passages poignants que je trouve le récit de Tran To Nga particulièrement pertinent et intéressant historiquement. A tous les niveaux, il propose un point de vue inhabituel qui change la perception du conflit et renverse les stéréotypes. Il y aurait évidemment beaucoup plus à dire car le livre regorge d’événements et de rebondissements digne d’un film, mais je laisse cette découverte aux futurs lecteurs.
Ce que je retiens de la lecture de Ma terre empoisonnée, c’est que l’histoire est subjective. Selon qui la raconte, elle peut prendre des visages différents, et ceux qui parlent le plus fort ne sont pas toujours ceux qui ont raison. En partageant ses souvenirs intimes, Tran To Nga parvient à proposer à la fois une fresque historique très vive, mais aussi un récit de vie secouée par les drames et les moments de joie. Les horreurs de la guerre y sont certes, difficiles à lire, mais toujours contrebalancés par une foi en la bonté humaine. J’en suis sortie bouleversée, et je ne peux qu’insister sur le fait qu’il est nécessaire de lire et faire lire ce genre de témoignages pour mieux comprendre notre passé, et aller de l’avant.
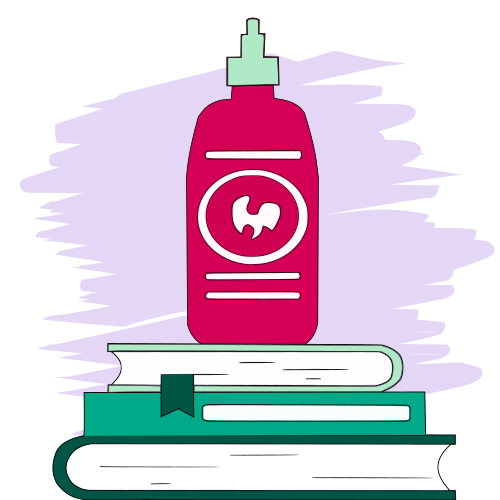

1 réflexion au sujet de “Ma terre empoisonnée de Tran To Nga”